Ils etait au Canada Ayaba Cho. John Mbah Akuroh. Dabney Yerima. Ebenezer Akwanga. Capo Daniel. Marianta Babila, avec mission d’abandonner la lutte pour l’indépendance. Pas de référendum. Pas de restauration. Juste la reddition.
Par un envoyé spécial intégré au Québec
Je me souviens de l’odeur de la moquette dans cet hôtel de Québec. Un parfum épais, artificiel, masquant le poids des conversations qui allaient se dérouler à huis clos. J’étais là — non pas comme invité d’honneur, mais comme des yeux et des oreilles dissimulés dans l’ombre, observant nos prétendus « représentants » marcher droit dans le piège de l’Histoire.
Ils arrivaient un par un ou par petits groupes, tirant des valises sur le sol brillant. Ayaba Cho. John Mbah Akuroh. Dabney Yerima. Ebenezer Akwanga. Capo Daniel. Marianta Babila. Et quelques autres dont l’Histoire pardonnera peut-être les noms, tant ils étaient insignifiants. Leurs voyages, leurs chambres et leurs repas — payés par La République du Cameroun, le même régime dont les soldats avaient brûlé nos villages et abattu nos enfants.
À la tête de la table, les Canadiens affichaient des sourires polis. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, présidait les discussions avec l’air de croire que la paix n’était qu’une question de signatures et de champagne. En face, côté camerounais, Elvis Ngolle Ngolle et un diplomate aux yeux perçants de l’ambassade du Cameroun à Ottawa.
J’ai vu la scène se dérouler. L’un après l’autre, les piliers de notre cause étaient grignotés, non par des balles, mais par des concessions :
Abandonner la lutte pour l’indépendance. Pas de référendum. Pas de restauration. Juste la reddition.
Effacer les causes profondes. Plus aucune mention de 1961, du traité d’union manquant, ni de notre Histoire.
Obtenir une amnistie pour les exilés. Un retour en sécurité pour les dirigeants — à condition qu’ils renoncent à la lutte.
Recruter les ex-combattants dans l’armée camerounaise. Transformer nos défenseurs en bourreaux pour l’occupant.
Libérer les prisonniers politiques — présenté comme un acte de clémence, mais seulement si la cause mourait avec eux.
Désarmer les combattants des brousses. Les envoyer au Ghana ou au Nigeria avec un billet sans retour.
Arrêter les financements de la diaspora. Affamer les ressources de la révolution.
Ramener la “normalité” dans le Cameroun méridional. Une normalité… sous occupation.
Les « cadeaux » promis par Yaoundé en retour relevaient de la farce : déplacer quelques soldats dans les casernes tout en construisant davantage de bases militaires, et promettre un port en eau profonde à Victoria ainsi qu’un aéroport à Tiko. Je voyais le rictus dans les yeux de Ngolle Ngolle — ce n’étaient pas des concessions, mais des trophées.
Le plan était de présenter cet « accord de paix » à Yaoundé en grande pompe, en proclamant que la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest était réglée. Mais le Canada publia le communiqué le premier, et dans l’embarras qui suivit, le Cameroun nia l’existence même des discussions.
Depuis mon coin discret dans cette salle, je savais que ce n’était pas une négociation ratée. C’était une autopsie — la dissection d’une révolution par les mains mêmes qui avaient juré de la protéger.
Le fantôme économique de Québec
Aujourd’hui, le fantôme de cette trahison hante encore les deux camps. Pour l’Ambazonie, ce fut un face-à-face avec l’extinction — un rappel que les traîtres peuvent accomplir en un week-end ce que l’armée ennemie n’a pas réussi en des années. Pour le Cameroun, ce fut le moment où ils perdirent leur dernière chance d’obtenir une paix à moindre coût.
La guerre continue de vider leurs caisses.
Le port de Victoria et l’aéroport de Tiko restent des dessins sur papier.
Les exportations de bananes, de cacao et de bois se sont effondrées.
La dette explose, alimentée par Paris et Pékin pour entretenir une machine militaire sans fin.
Dans cette salle de Québec, ils croyaient négocier une fin. En réalité, ils rédigeaient le scénario de l’effondrement lent et douloureux d’une économie trop arrogante pour faire la paix, et trop faible pour gagner la guerre.
Je suis sorti de cet hôtel dans le froid mordant de Québec, les mains enfoncées dans les poches de mon manteau, portant un secret que je savais destiné à éclater au grand jour. Ce jour est arrivé. Et avec lui, l’heure des comptes.















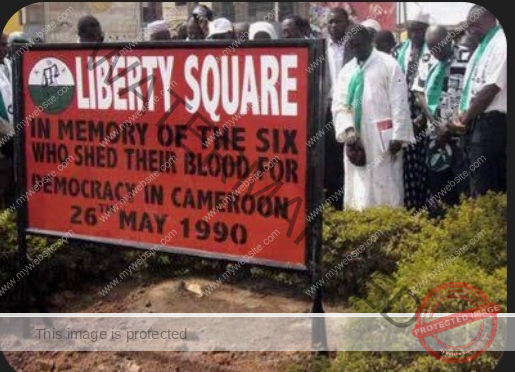





Leave feedback about this