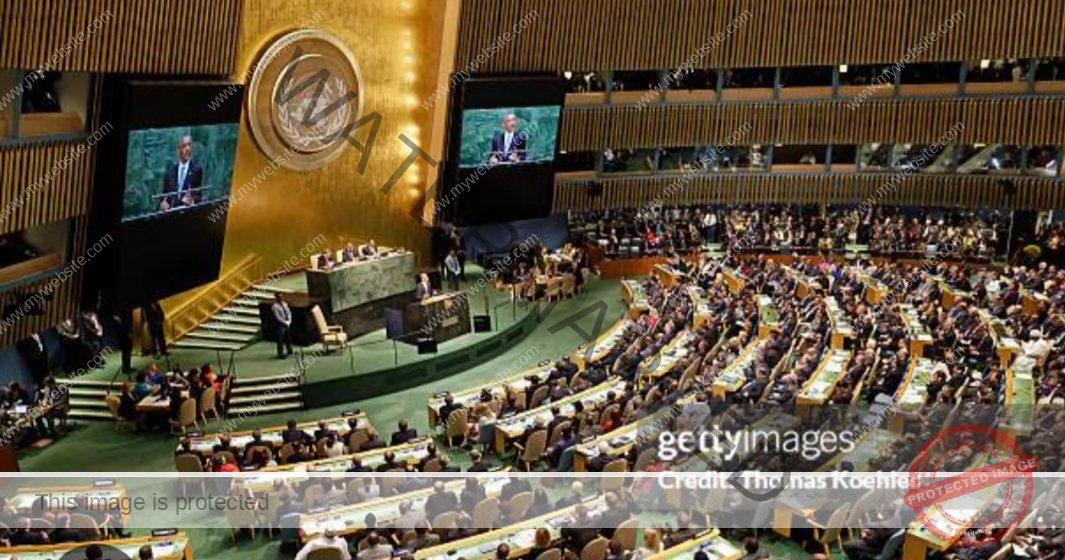Ies tentatives répétées des dirigeants et avocats ambazoniens d’engager le Comité de décolonisation des Nations Unies ont échoué.
Par Ali Dan Ismael, Rédacteur en chef
Pour les Ambazoniens, les Nations Unies représentent à la fois le forum qui a nourri nos espoirs et l’institution qui a échoué à les concrétiser. De nombreux articles, mémorandums juridiques et enquêtes historiques sont revenus sur la question centrale de notre décolonisation. Les preuves sont accablantes : le processus n’a jamais été finalisé.
Le résultat du plébiscite de 1961 n’a jamais été ratifié par le Parlement du Cameroun méridional. La Constitution fédérale qui a suivi a été imposée sans le consentement de nos représentants élus. Et, surtout, les conditions mêmes de la formation d’un système fédéral — définies par les Nations Unies — n’ont jamais été respectées par la République du Cameroun (LRC).
Pourtant, malgré ce faisceau de preuves, les tentatives répétées des dirigeants et avocats ambazoniens d’engager le Comité de décolonisation des Nations Unies ont échoué. La réponse a toujours été brève et catégorique : « Le dossier du Cameroun méridional est clos. »
Le veto français au Conseil de sécurité
Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la réalité est encore plus complexe. La France, en tant que principal défenseur du Cameroun, s’est constamment opposée à toute tentative de rouvrir la question de la souveraineté du Cameroun méridional. Même lorsque les États-Unis et d’autres membres ont tenté d’inscrire cette question à l’ordre du jour, l’influence diplomatique française et l’usage de son veto ont bloqué tout progrès.
Ainsi, depuis plus de soixante ans, la question de l’autodétermination ambazonienne reste non résolue — non pas parce que les preuves manquent, mais parce que la volonté politique fait défaut.
L’immunité juridique des Nations Unies
Un autre obstacle réside dans le fait que les Nations Unies sont, en pratique, au-dessus de la loi. Elles ne peuvent pas être poursuivies pour leurs erreurs, aussi graves soient-elles, et aucun tribunal international n’acceptera de juger une affaire contre l’ONU pour avoir manqué d’achever la décolonisation. Cette immunité structurelle signifie que les Ambazoniens ne peuvent pas espérer de réparation en traduisant les Nations Unies devant la Cour internationale de Justice ou un autre tribunal.
La responsabilité incombe donc aux Ambazoniens eux-mêmes : continuer à utiliser les canaux politiques, juridiques et diplomatiques afin de contraindre les Nations Unies et la communauté internationale à reconnaître les conséquences de cette décolonisation inachevée.
Y a-t-il encore de l’espoir pour le Cameroun méridional ?
La réponse est oui. Le génocide en cours dans notre patrie ne pourra pas rester invisible indéfiniment. L’incendie délibéré de villages, les massacres de masse, les déplacements forcés et l’effacement de l’identité ambazonienne forceront, tôt ou tard, les Nations Unies et la communauté internationale à agir.
Et dans le cadre du traitement de cette catastrophe humanitaire, la cause profonde — notre décolonisation inachevée — reviendra nécessairement sur la table. C’est exactement là où nous en sommes aujourd’hui :
La Résolution 684 du Sénat américain a déjà inscrit la crise anglophone du Cameroun dans la politique étrangère des États-Unis.
Le processus avorté de Dialogue Plus mené par la Suisse a démontré que des médiations cosmétiques ne peuvent résoudre une injustice structurelle.
Les plaintes déposées devant la CPI par des avocats ambazoniens inscrivent désormais les crimes de génocide et les crimes contre l’humanité dans les cadres juridiques internationaux.
L’Ambazonie est donc sur la bonne voie — non pas parce que l’ONU a choisi de se corriger, mais parce que la persistance de notre peuple et la gravité des crimes commis contraignent le monde à ouvrir les yeux.
La position du Dr Sako
Le Dr Samuel Ikome Sako, Président de la République fédérale du Cameroun méridional Ambazonie en exil, a été clair et constant à ce sujet
« Les Nations Unies ne revoient pas facilement leurs erreurs passées. Mais l’histoire montre que les génocides ne laissent aucune place au silence. La destruction de nos communautés, la résilience de notre peuple et notre engagement envers l’autodétermination légale garantiront que la question de l’Ambazonie revienne sur la scène mondiale. Nous ne réclamons pas de nouveaux droits — nous exigeons l’achèvement d’un processus que les Nations Unies elles-mêmes ont lancé en 1961 mais qu’elles ont laissé inachevé. »
Le Dr Sako a également souligné que les instruments juridiques internationaux existent déjà :
La Résolution 1608 (XV) de l’ONU exigeait que les résultats du plébiscite de 1961 soient finalisés avec le Gouvernement du Cameroun méridional et dûment enregistrés auprès des Nations Unies. Cela n’a jamais été fait.
L’article 76(b) de la Charte des Nations Unies stipule clairement que l’objectif d’un territoire sous tutelle est l’indépendance ou l’autonomie. L’annexion n’a jamais été une option.
La Déclaration de Montevideo de 1933 définit quatre critères de l’État : une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et la capacité d’entrer en relations avec d’autres États. Le Cameroun méridional remplissait déjà ces critères en 1961 — et les remplit encore aujourd’hui.
La Charte du Commonwealth (2013) réaffirme le droit des peuples à l’autodétermination. En tant qu’ancien territoire administré par le Royaume-Uni et membre de la famille du Commonwealth, le Cameroun méridional est en droit d’attendre que ces principes soient respectés.
La leçon
La leçon pour les Ambazoniens est à la fois dure et porteuse d’espérance : les Nations Unies ont historiquement eu du mal à corriger leurs erreurs, et leur immunité signifie qu’elles ne peuvent pas y être contraintes par voie judiciaire. Ce n’est pas la seule clarté morale qui provoque le changement, mais la crise.
Voilà pourquoi les Ambazoniens doivent rester fermes. Par la résilience, la résistance civile, le plaidoyer international et les actions juridiques, le génocide commis aujourd’hui forcera un jour le monde à traiter la question inachevée de notre indépendance.
L’Ambazonie est sur la bonne voie — non pas parce que l’ONU s’est corrigée, mais parce que la vérité, la justice et la persistance d’un peuple ne peuvent pas être enterrées à jamais.
Ali Dan Ismael, Rédacteur en chef